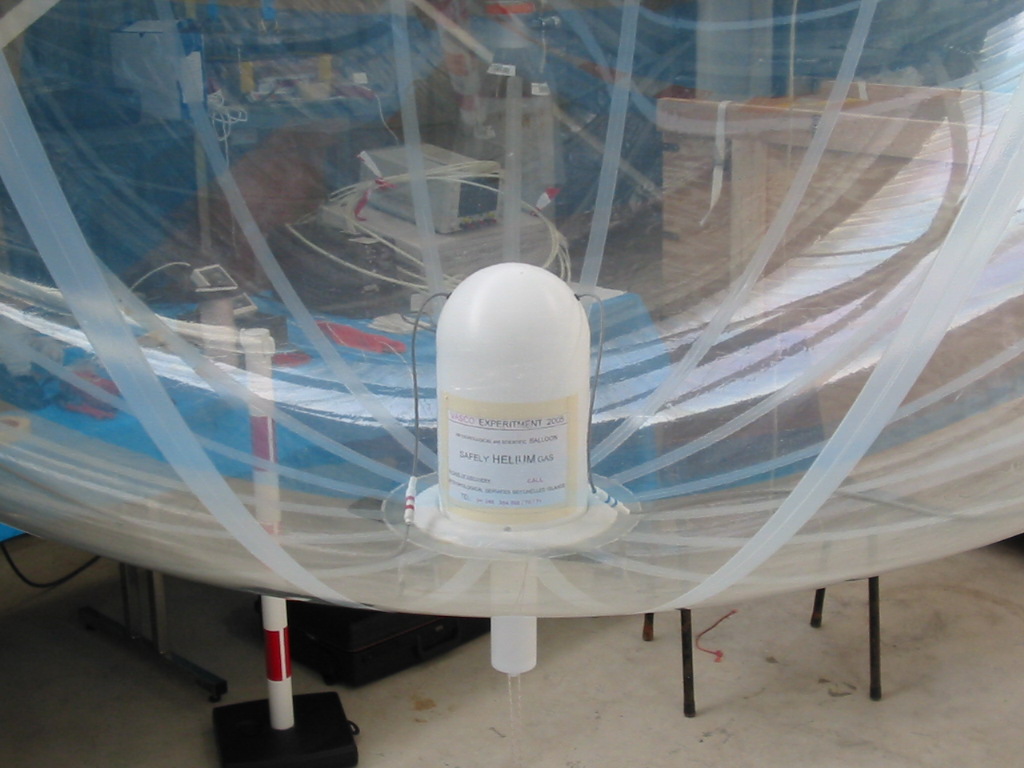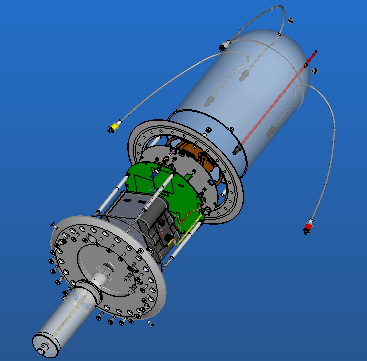|
|
BALLONS
PRESSURISES DE
COUCHE LIMITE (BPCL)
|
|
C’est
en 1972, à la suite de
l’expérience EOLE qui avait déployée avec
succès 480 ballons pressurisés à 200hPa, que D.
Cadet et H. Ovarlez du Laboratoire de Météorologie
Dynamique (LMD) ont commencé à étudier
l’utilisation de ballons pressurisés pour étudier la
couche limite atmosphérique (BPCL).
Deux
expériences préliminaires
-
22 ballons depuis
l’île
de Rangiroa dans le Pacifique Sud en 1973,
-
10 ballons depuis
l’île
d’Ascencion dans l’Atlantique Sud en 1974
ont
permis de
cerner les difficultés
de tels vols (Cadet & al. 1975, J. Appl. Met, 14, pp. 1478-1484).
Ces difficultés tiennent d’une part aux excursions
verticales dues aux refroidissements et chauffage radiatifs de
l’enveloppe, mais surtout, aux effets des pluies tropicales qui
peuvent projeter le ballon jusqu’à la surface. Pour des
ballons de 2m de diamètre, ils estimaient la charge en eau
sous une averse à 500g et une pression dynamique
supplémentaire due aux gouttes de l’ordre de 1000g. La
structure de l’aérostat dérivée de celui
d’EOLE, avec une chaîne de vol suspendue sous le ballon ne
permettait pas de résister à ces
évènements,
l’instrumentation étant détruite quand le ballon
arrive à la surface de l’océan (expérience de
Rangiroa). C’est pourquoi il a été imaginé de
mettre la nacelle scientifique et de servitude à
l’intérieur
même du ballon de telle façon que le ballon puisse se
poser sans dommage sur l’océan.
Cette
solution à été
testée lors des vols depuis Ascencion, puis utilisée
lors des expériences :
-
Summer monsoon (45
ballons
lancés des Seychelles en 1975 ; D. Cadet et H. Ovarlez,
Quart. J. R. Met Soc, 1976, 102, pp 805-815),
-
BALSAMINE (60 ballons
depuis
les Seychelles et 28 ballons depuis Diego-Suarez en 1979 ; D.
Cadet & al., Bull. Am. Meteor. Soc, 1981, 62, pp. 381-388),
-
INDOEX (17 ballons
lancés de Goa en 1999 ; Ethe et al., J. of Geophys. Res.,
107D19, 2002, INX2-22-1:19)
-
BOA (8 ballons
lancés
d’Ushuaia en 2000 ; Ethe, thèse de Doctorat, Paris 2001).
-
VASCO
2005 (5 ballons depuis
les Seychelles; http://www.lmd.ens.fr/tromeur/VASCO)
-
VASCO
2006 (4 ballons depuis
les Seychelles; http://www.lmd.ens.fr/tromeur/VASCO)
Ces ballons
pressurisés ont été conçus et construits
entièrement au LMD jusqu'à l'expérience BOA. Les
ballons sont maintenant développés par le CNES, les
enveloppes des ballons étant fabriquées par ZODIAC
INTERNATIONAL.
|
 |

|

|
Les
ballons pressurisés gardent un volume quasi-constant et volent
donc à un niveau de densité quasi-constant, agissant
comme des traceurs Lagrangien des parcelles d'air et des plateformes
météorologiques. Produits par ZODIAC sous la supervision
du CNES, les ballons sont gonflés d'hélium avec une
surpression nominale de 120 hPa au niveau de vol. L'enveloppe est
un tri-laminé polyéthylène de 125
micromètres
d'épaisseur a un diamètre sphérique de 2.5 m. Par
ailleurs, avec une masse totale d'environ 9 Kg, ce véhicule peut
voler dans des couches atmosphériques comprises entre la surface
et environ 830 hPa en fonction de son lest. Aussi longtemps que la
surpression est maintenue, le volume reste constant, excepté
pour de légères fluctuations thermiques produisant de
faibles oscillations de l'altitude de vol, principalement conduites par
le cycle diurne.
Proche de leur niveau de densité à l'équilibre,
ces
ballons sont de bons traceurs du mouvement horizontal. Cependant, ils
pourraient
réagir aux coups de vent par des petites amplitudes, des hautes
fréquences et des oscillations verticales autour du niveau
d'équilibre. Le
problème le plus sérieux encouru est la charge en eau
accumulée par la pluie ou la condensation quand la
température de l'enveloppe
descend sous la température au point de Rosé. Ce dernier
cas pourrait arriver quand le ballon entre dans de l'air saturé
ou si
l'hélium se refroidit du fait de la radiation nocturne. |

|
Concernant
l'instrumentation scientifique embarquée, la charge
utile des ballons comporte un capteur d'humidité (Figure en haut
à gauche), des capteurs de pression et de température
(Figure en bas à gauche) et un
GPS 3D. La pression et la température de l'hélium sont
aussi enregistrées. Les données sont émises, avec
une
période moyenne de 15 minutes, via le système ARGOS.
L'énergie est fournie par des batteries au lithium assurant une
durée de vie d'environ un
mois. Les batteries, l'électronique, les antennes ARGOS et GPS
sont toutes regroupées à l'intérieure de
l'enveloppe du
ballon (Figures à droite), protégées ainsi de
l'eau
salée lorsque que le ballon touche ou descend près de la
surface de l'océan.
|
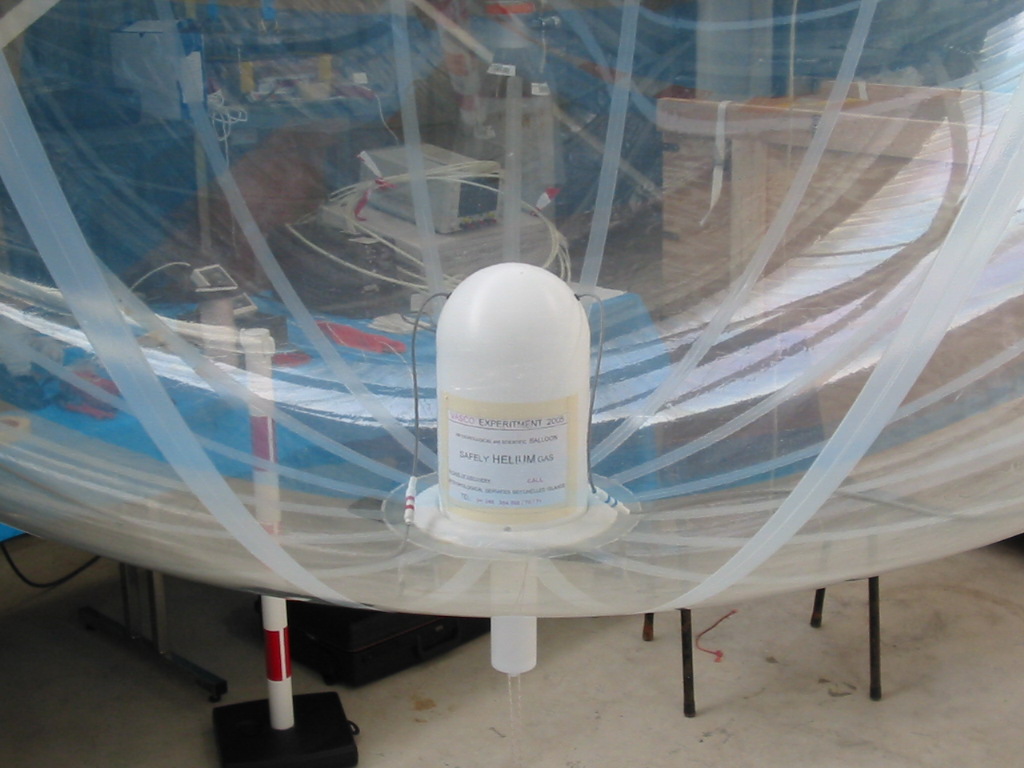 |

|
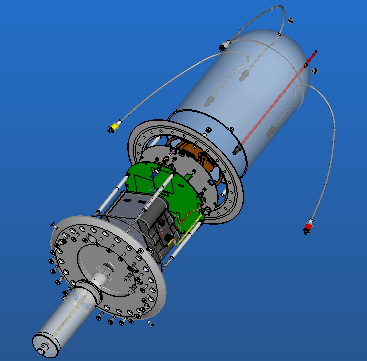
|
|